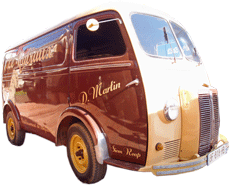Le Cambodge kiri
La gare de Bangkok ne manque pas de charme. En débarquant, il nous sera facile de prendre un billet pour rejoindre Aranyaprathet par le train de 13h, dernière ville Thaïlandaise avant la frontière. Nous réalisons de justesse que le lieu où nous souhaitions nous poser pour attendre est en fait réservé aux moines, jouissant d’un statut d’exception. Nous dépassons les immenses photos du roi considéré ici comme un demi-Dieu, pour aller nous caler à l’étage. Nous payons un prix dérisoire (3 euros pour nous quatre) pour un trajet de 270 km qui durera tout de même 6 heures. Le train de 3e classe est fatigué et les ventilateurs qui s’agitent dans tous les sens au plafond ne parviennent pas à rafraichir les wagons, pas davantage que l’air qui s’infiltre par les fenêtres grandes ouvertes. La chaleur augmente au fil des arrêts alors que le train n’en finit pas de se remplir tel un métro parisien aux heures de pointe. Beaucoup voyagent debout au milieu des chargements des Thaïlandais de la campagne venus se ravitailler en ville en toutes sortes de produits qui débordent des sacs.
C’est au milieu d’un paysage agricole que ce train s’arrête au milieu de nulle part, un simple abri servant de gare la plupart du temps. Par les fenêtres, la Thaïlande nous offre le spectacle des moissons et des rizières peuplées de hérons, une fois passée la série des habitats précaires qui s’établissent comme toujours le long des voies ferrées des grandes villes.
agricole que ce train s’arrête au milieu de nulle part, un simple abri servant de gare la plupart du temps. Par les fenêtres, la Thaïlande nous offre le spectacle des moissons et des rizières peuplées de hérons, une fois passée la série des habitats précaires qui s’établissent comme toujours le long des voies ferrées des grandes villes.
Nous passons la nuit dans un motel et profitons de sa piscine avant de repartir, visa pour le Cambodge en poche, vers la fameuse frontière séparant deux royaumes qui ne s’aiment guère et s’entretuent à l’occasion pour un temple mal placé, à cheval entre deux pays. L’histoire a pris une dimension internationale sans être pour autant réglée à ce jour. Nous avions lu de nombreux commentaires alarmants sur le passage de la frontière, qui se fait à pied, mais l’affaire ne nous a pas semblé si compliquée que cela : on marche, on décline les propositions de taxi, on fait la queue, on marche, on fait la queue, on décline les propositions de taxi, et voilà, le tour est joué. Nous prenons ensuite une navette gratuite pour la gare des bus d’où nous prendrons un van partagé avec Russes, Australiens, Allemands et Anglais. Nous rejoignons ainsi Siem Reap, après avoir retiré des dollars américains, seule devise que les ATM (distributeurs automatiques) veulent bien fournir.
Ceci n’est pas un problème  puisque le Cambodge tourne aux dollars, réservant aux petites sommes l’utilisation de la monnaie locale, le riel. Nous jonglons donc constamment entre trois monnaies. Il arrive souvent que l’on paye en dollars, mais qu’on nous rende la monnaie en Riels, ou inversement. On s’habitue finalement à l’exercice, une fois mémorisés les taux de change et leur équivalent en euros.
puisque le Cambodge tourne aux dollars, réservant aux petites sommes l’utilisation de la monnaie locale, le riel. Nous jonglons donc constamment entre trois monnaies. Il arrive souvent que l’on paye en dollars, mais qu’on nous rende la monnaie en Riels, ou inversement. On s’habitue finalement à l’exercice, une fois mémorisés les taux de change et leur équivalent en euros.
Le Cambodge nous réserve d’autres surprises, telle la profusion de produits français dans les magasins. Il faut alors gérer l’excitation des garçons béats devant un paquet de barquettes 3 chatons, le kiri et autres produits dont l’emballage est entièrement écrit en français. Demain, pour la visite des temples d’Angkor, nous nous payerons donc le luxe d’un sandwich baguette-jambon-beurre-gruyère. Le must de la gastronomie française est là, si proche, si désirable… Bref, les années d’occupation française ont laissé ici des traces encore palpables et des relations commerciales bien établies. Ce n'est pas la Vache qui rit qui s'en plaindra.
 À chaque pays ses tuk-tuks ! Ceux d’ici sont de petites carrioles tirées par des scooteurs qui déambulent avec agilité dans les rues, tels des carrosses modernes au milieu des vélos des années 40, des jeeps à l’ancienne ou des pickups rutilants. La modernité de Siem Réap nous surprend et la ville a un charme indéniable avec ses terrasses, ses ponts couverts, ses marchés et ses airs de petite ville provinciale. Les sapins de Noël que l’on voit de-ci de-là contrastent avec la chaleur étouffante qui invite à ménager ses efforts.
À chaque pays ses tuk-tuks ! Ceux d’ici sont de petites carrioles tirées par des scooteurs qui déambulent avec agilité dans les rues, tels des carrosses modernes au milieu des vélos des années 40, des jeeps à l’ancienne ou des pickups rutilants. La modernité de Siem Réap nous surprend et la ville a un charme indéniable avec ses terrasses, ses ponts couverts, ses marchés et ses airs de petite ville provinciale. Les sapins de Noël que l’on voit de-ci de-là contrastent avec la chaleur étouffante qui invite à ménager ses efforts.
Nous logeons juste en face d’une école, ce qui nous offre l’occasion d’aller visiter les vieux pupitres en bois où s’alignent les élèves en uniforme bleu et blanc face au tableau noir (voir aussi « école et jeux »). Autre visite, le centre « Handicap international » de Siem Réap. Le Cambodge garde longtemps les traces de son passé comme autant de déchirures sur les corps mutilés de ses enfants, victimes des mines que les Khmers rouges ont disséminées dans tout le pays. Nous découvrons comment le centre qui fonctionne avec du personnel local vient en aide aux personnes, remplaçant les jambes de bois artisanales par un matériel plus performant, permettant de reprendre le travail dans les rizières. Une main artificielle se dévisse ainsi pour être remplacée par une serpette ou un godet. Ingénieux ! Le centre comporte aussi des parcours pour s’entrainer sur les divers terrains rencontrés par les paysans pauvres, principales victimes d’une guerre terminée, mais qui tue encore, malgré la succession des programmes de déminage. Les enfants apprécieront cette visite instructive et pleine d’émotion (voir aussi l’article dans la rubrique « handicap »). Après les enfants des rues ou au travail en Inde, les enfants mutilés au Cambodge leur font prendre conscience de la précarité de la condition de bien des enfants de leur âge dans le monde.
corps mutilés de ses enfants, victimes des mines que les Khmers rouges ont disséminées dans tout le pays. Nous découvrons comment le centre qui fonctionne avec du personnel local vient en aide aux personnes, remplaçant les jambes de bois artisanales par un matériel plus performant, permettant de reprendre le travail dans les rizières. Une main artificielle se dévisse ainsi pour être remplacée par une serpette ou un godet. Ingénieux ! Le centre comporte aussi des parcours pour s’entrainer sur les divers terrains rencontrés par les paysans pauvres, principales victimes d’une guerre terminée, mais qui tue encore, malgré la succession des programmes de déminage. Les enfants apprécieront cette visite instructive et pleine d’émotion (voir aussi l’article dans la rubrique « handicap »). Après les enfants des rues ou au travail en Inde, les enfants mutilés au Cambodge leur font prendre conscience de la précarité de la condition de bien des enfants de leur âge dans le monde.